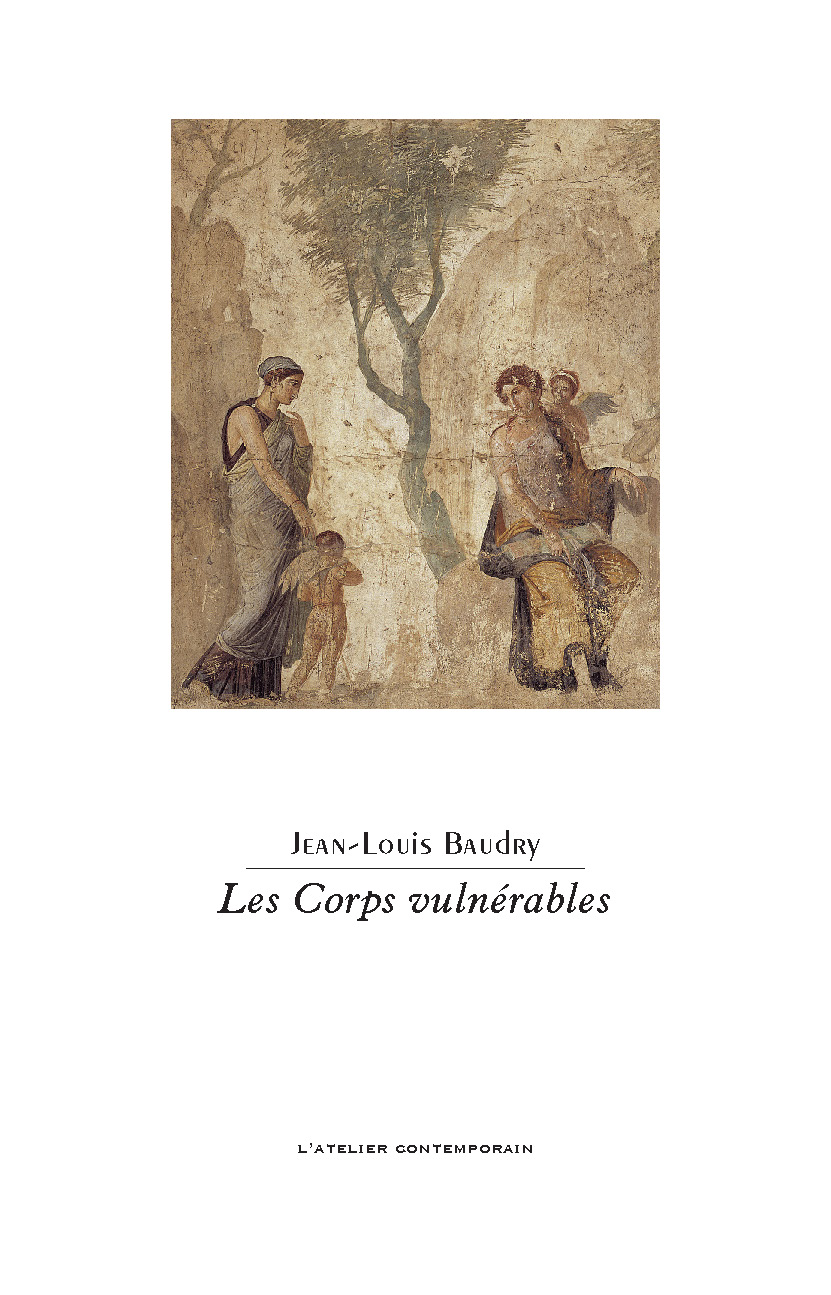
« Les Corps vulnérables » a été composé par Jean-Louis Baudry entre 1997 et 2010.
1200 pages pour dire l'amour, le deuil de l'être aimé. Par « corps », outre le sens habituel, il faut entendre ces corps d'ombre symboliques et spirituels que les poètes, visiteurs des enfers, ont rencontré, mais aussi le corps de la mémoire et ceux, aléatoires, de nos sentiments.
Ce travail a répondu à la nécessité de rassembler à la mort de la femme aimée tout ce qui, jusque dans les moindres détails, avait été vécu avec elle. Entreprise qui répondait ainsi à la double exigence de maintenir par les seuls moyens de l'écriture une présence et d'explorer le volume sans fond de la mémoire.
Témoignage d'Anne Baudry, fille de l'écrivain :
Par la fenêtre de sa chambre, de grands arbres et le ciel. En face du lit, un secrétaire où s'entassent les tirages papiers de ses textes, de ce livre-ci, Les Corps Vulnérables, qui pèse son poids et en ploie l'abattant.
Son lit, proche de la fenêtre, m'apparaît au centre de la pièce comme l'espace privilégié de l'intimité avec soi-même. J'imagine un radeau, non, pas un radeau, une île plutôt, cernée de livres comme un refuge pour l'occupation solitaire de l'écriture.
À moitié allongé, le dos calé contre des oreillers, les genoux repliés pour y adosser une planche en bois, il écrit. Il adopte cette posture il y a longtemps pour vaincre un mal de dos obstiné. Elle devient la position même de l'écriture. Elle renoue avec les poses de l'enfance, lorsqu' à moitié allongé on s'abandonne à la lecture, au rêve qui l'accompagne.
Il lève le nez vers la fenêtre, il observe sur une branche la pie qui fait son nid, il me raconte plus tard l'incessant ballet des brindilles, le méticuleux et patient ouvrage de l'oiseau, il surveille la couvée, s'inquiète de la naissance des petits puis de ce qui les menace, se réjouit de leur premier vol – il écrit.
Dans le silence de sa chambre – enfant je devais veiller à ne pas faire de bruit –, il écrit.
Si je reviens à quelques impressions très anciennes, je me souviens d'avoir pressenti, sans le comprendre tout à fait, que derrière la porte s'accomplissait une tâche quasi-sacrée, un même rituel qui réglait notre quotidien chaque jour, absolument tous les jours, vacances comprises : tous les matins mon père s'enfermait dans sa chambre pour écrire. L'après-midi il exerçait son métier de chirurgien-dentiste. Puisqu'il était aussi dentiste. Il s'en tient à cette stricte discipline – si j'avais eu les mots alors, j'aurais dit implacable– jusqu'à sa retraite. Mais comment aurais-je-pu deviner que cette nécessité d'écrire trouvait sa source dans la vie même, l'écriture infusant la vie que la vie en retour insuffle ? « J'allais dans ma chambre, je me mettais àécrire, je tournais les yeux vers la fenêtre, il faisait beau et je retrouvais le bonheur que j'avais toujours connu, cette humeur avait résistéà tous les chagrins, à tous les arrachements, aux ruptures et aux angoisses, je l'avais perçu dans les années contraires de mon enfance et de ma jeunesse. »
Ainsi cette phrase par laquelle enfant je tentais de le définir, « mon père est écrivain », devenait avec le temps la reconnaissance d'un état inséparable de son être.
Dans l'appartement qu'il occupe depuis toujours, toute la mémoire de sa vie est là, invisible aux yeux des autres, enfouie dans des placards, cachée dans des tiroirs ou exposée, comme cette collection d'objets en argent devant une fenêtre, cadeaux modestes qu'il conserve par délicatesse envers ceux qui les ont offerts, choses insignifiantes mais auxquelles s'accrochent d'infimes souvenirs, d'inestimables souvenirs, parce qu'ils entraînent à leur suite les mots qui sauvent une lumière, une heure, un moment, une histoire, un visage, un monde, de l'oubli.
Sa vie d'écrivain paraît simple, presque ascétique, soumise à ces rituels que l'écriture commande. Sa vie d'homme se tourne vers les femmes, les passions, l'amour. Je n'en reçois que les échos lointains, mais je me souviens qu'enfant je percevais avant de sombrer dans le sommeil les éclats qui traversaient les murs d'un tumulte passionné.
Derrière les vitres de sa bibliothèque il a glissé des images, beaucoup d'images. Des reproductions de peinture, des photogrammes – je reconnais une image de Peter Ibbetson, le film d'Henri Hataway –, quelques photos de ses amis, de sa famille ; et pendant toute la rédaction des Corps Vulnérables des photos qu'il a prises d'elle, Marie son amour. J'en distingue une, en noir et blanc qu'il a fait tirer en grand : on la voit de profil, le visage tourné vers le haut, ciel ou plafond et son visage m'évoque celui d'Ingrid Bergman dans les derniers plans de Stromboli. Il n'est pas dit qu'il n'y ait pensé lui-même et que la photo ne porte aussi cette réminiscence. Une autre photo m'attire, c'est un polaroid de petite dimension pris dans le jardin des Tuileries. Ils se tiennent tous deux proches l'un de l'autre, ils sourient et distribuent des miettes de brioche aux pigeons qui forment cercle autour d'eux. Photo de retrouvailles, écrira-t-il dont : « un ange venu d'ailleurs qui se dissimulait sous l'apparence triviale d'un photographe de rue avait été chargé de fixer les instants. »
Et puis un jour la mort brutale de la femme aimée. Je ne l'ai pas connue, j'ignore presque son existence, il ne parle pas d'elle, ne se confie pas.
J'aimerais qu'il se console, qu'il s'arrache à sa souffrance.
Il oppose à toutes les tentatives pour le détourner de sa peine une résistance farouche : il écrit.
Il m'apprend qu'il ne faut pas chercher à le distraire ; mais respecter le silence de chaque matin, ne pas téléphoner, ne pas le déranger ; ne pas lui parler de vacances ou de voyages ; mais accepter sa solitude habitée par la présence de Celle que l'écriture ressuscite, de Celle par laquelle une œuvre est en train d'advenir grâce à cet autre voyage dans la mémoire et dans le temps qui durera plus de dix ans.