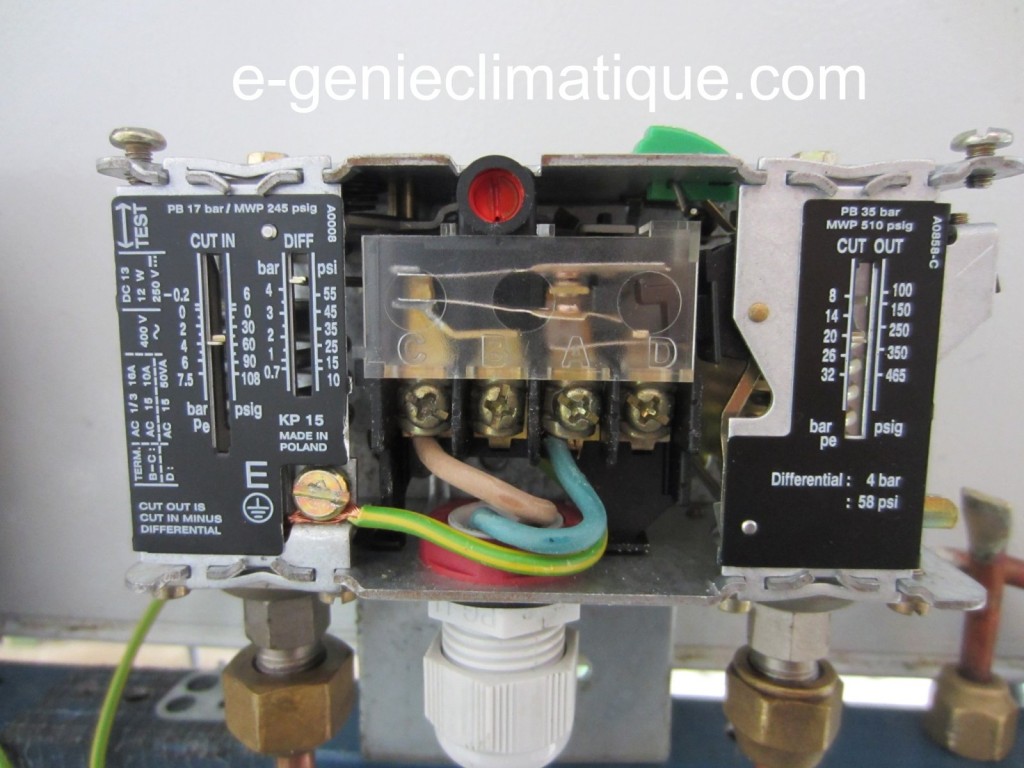Dans la décennie qui précède la publication de Terraqué, Guillevic – encore un inconnu, un apprenti – s'adonne à une forme d'écriture intime vouée à céder ensuite entièrement la place au poème. Ces notations discontinues, très personnelles, recueillies dans des carnets ou sur des feuilles volantes, relèvent tantôt de l'entrée de journal, du fragment introspectif, de la chose vue, de la note de lecture, de la tentative critique ou de l'essai de poème.
Inédits pour la plupart, et rassemblés pour la première fois dans ce recueil, ces feuillets mettent au jour la pulsation d'un travail quotidien sur soi, l'espoir d'arriver au poème. Grâce à eux, nous saisissons mieux d'où provient l'œuvre, c'est-à-dire non seulement le tourment dont elle procède, mais l'immense effort de maîtrise qu'elle a requis. S'il est vrai qu'on ne naît pas, mais qu'on se reconnaît poète, on peut dire qu'on assiste ici au devenir de Guillevic.
Sont réunis dans ce volume : le Carnet du Val-de-Grâce, tenu entre Strasbourg, Paris et Huningue de janvier 1929 à janvier 1930 ;
le Carnet du Val-de-Grâce, tenu entre Strasbourg, Paris et Huningue de janvier 1929 à janvier 1930 ; le Cahier d'août 1935, qui a vu le jour à Mulhouse et Paris entre le 9 août et le 1er septembre 1935 ; et
le Cahier d'août 1935, qui a vu le jour à Mulhouse et Paris entre le 9 août et le 1er septembre 1935 ; et Lieux communs, une douzaine de feuillets non datés, couverts de réflexions théoriques d'un degré conséquent d'élaboration.
Lieux communs, une douzaine de feuillets non datés, couverts de réflexions théoriques d'un degré conséquent d'élaboration.
EXTRAIT DE LA PRÉFACE DE MICHAEL BROPHY :
Contrairement au poème guillevicien qui aspire à la permanence, le journal donne libre cours à l'humeur changeante de son auteur. Doté d'une forte charge pulsionnelle, il saisit sur le vif l'état d'esprit d'un instant dans un flux scriptural que nul repentir ni retouche ne viennent endiguer. Dans des notations brutes, l'auteur se livre à nu et simultanément prend acte d'un « examen à froid » qui le dépouille de sa substance, et même volatilise bien plus qu'il ne clarifie les traits de sa personne. Dans de pareils moments, un tel exercice représente l'inverse d'une stratégie d'édification, car c'est bien plutôt un supplice d'écorché vif qui l'accule sans merci à la béance d'un vide.
(…)
Alors qu'il nous conduit à l'orée de l'œuvre, qu'il en brasse des bribes ou des germes, le journal se tient lui-même inéluctablement en dehors d'elle, exhibant ce qui se trame spontanément au fil de la plume – et qui s'arrache perpétuellement à soi plutôt qu'il ne se retourne et se ramasse sur soi pour polir ses aspérités, maîtriser son élan. En revanche, cette matière visiblement hachée et dispersée, déposée telle quelle sous la dictée fuyante de l'instant, fait non seulement partie du terreau d'oùémerge l'œuvre, mais elle veille sans relâche à cette émergence, demeure tout entièrement tendue vers elle.